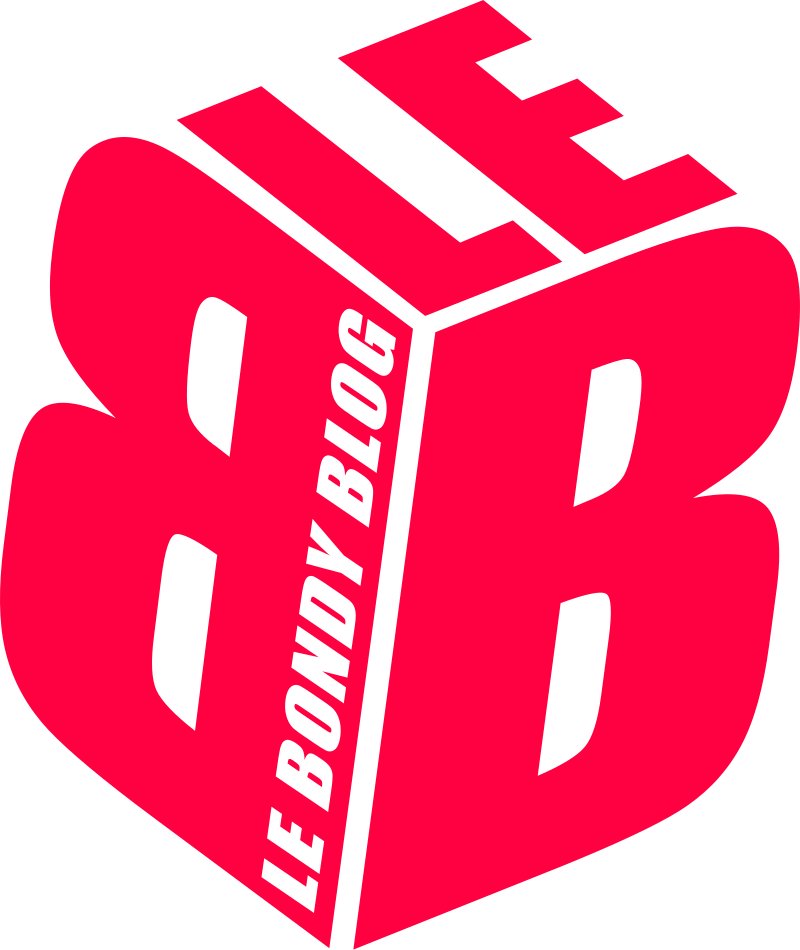La presse et la marche
La couverture médiatique de la Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme de 1983 a été initialement limitée, mais a évolué au fil du temps.
Début de la Marche : Indifférence des grands médias
Au départ de Marseille le 15 octobre 1983, la Marche a été largement ignorée par les grands médias nationaux. Cette indifférence médiatique a persisté pendant les premières étapes de l’événement.
Rôle crucial des médias indépendants
Face à ce manque de couverture, un réseau de médias indépendants s’est mobilisé pour documenter la Marche :
Ces médias, souvent issus des communautés immigrées, ont formé un "pool" pour assurer une couverture en continu de l’événement
Contribution des photographes indépendants
Pierre Ciot, photographe indépendant, a joué un rôle important en immortalisant le départ de la Marche. Ses photos ont été acceptées par l’AFP. Certaines ont été diffusées par l’AFP et sont devenues des archives uniques sur cet événement important.
Il y a des fanzines comme Rencar de Corbeilles-Essonne qui ont rejoint cette dynamique pour produire un contenu indépendant. Cela a permis de relater les étapes de la Marche tout en mobilisant leurs publics dans un contexte souvent hostile.
La collaboration entre militants et journalistes a préfiguré un réseau national transversal, dynamique et imaginatif. Les archives produites par ces acteurs restent aujourd’hui des témoignages précieux.
Évolution de la couverture médiatique
La situation a changé après un événement tragique :
- Point tournant : L’assassinat d’Habib Grimizi le 14 novembre 1983 a marqué un changement dans la couverture médiatique
À partir de cet événement, les grands médias nationaux et locaux ont commencé à couvrir plus largement la Marche.
Les radios libres ont commencé à émerger en France à partir de 1977
Les radios libres ont commencé à émerger en France à partir de 1977, s’inspirant des expériences anglo-saxonnes et italiennes. À cette époque, la France était sous un régime de monopole d’État en matière de radiodiffusion, ce qui rendait ces émissions illégales.
Sous les gouvernements de Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac et Raymond Barre, les radios libres ont fait face à une forte répression. Les autorités utilisaient diverses méthodes pour contrer ces émissions :
- Radiogoniométrie pour localiser les émetteurs
- Interventions policières
- Saisies de matériel
- Arrestations et procès
- Brouillage des fréquences
L’élection de François Mitterrand en 1981 a marqué un tournant décisif pour les radios libres. Dès novembre de la même année, les radios pirates sont devenues légales, bien qu’avec certaines contraintes :
- Interdiction de former des réseaux
- Limitation de la puissance d’émission
- Interdiction de diffuser de la publicité
La légalisation des radios libres a entraîné une explosion du nombre de stations FM en France. Face à cette croissance rapide, le gouvernement a dû mettre en place un cadre réglementaire :
- Novembre 1981 un décret permettant des dérogations au monopole d’État
- Juillet 1982 la loi-cadre réformant le système audiovisuel et créant la Haute Autorité de la communication audiovisuelle
- Août 1984 l’autorisation de la publicité, marquant le début de la professionnalisation du secteur
La naissance des radios libres a profondément transformé le paysage médiatique français. En moins de quatre ans, la France est passée d’un système quasi monopolistique à un environnement radiophonique diversifié, comprenant le service public, les radios périphériques, les radios locales privées associatives et les stations commerciales.
Aujourd’hui, bien que l’ère des radios libres soit révolue, leur héritage persiste dans la diversité du paysage radiophonique français et dans les innovations continues du secteur face aux défis de l’ère numérique
Journal "Sans Frontière"
La création du journal "Sans frontière" s’inscrit dans une période de mobilisation croissante autour des questions d’immigration. Ce journal a contribué à donner une voix aux communautés immigrées et à sensibiliser l’opinion publique sur leurs préoccupations et leurs droits.
Sans frontière est le premier hebdomadaire indépendant intercommunautaire de l’immigration lancé en mars 1979 jusqu’en octobre 1985. Initié par les anciens membres du Mouvement des Travailleurs Arabes, parmi lesquels Saïd Bouziri, Mokhtar Bachiri, Mogniss H. Abdallah, Manuel Diaz, Abdelmalek Sayad, Driss El Yazami, Adil Jazouli, Farid Aichoune...
Le journal avait pour objectif d’intervenir dans le domaine de l’information et plus particulièrement sur les questions liées à l’immigration. Il reste vigilant sur toute forme de discrimination notamment contre les populations issues de l’immigration. Il publie des informations des cultures d’origine pour les faire connaitre...
En mars 1986, il change de nom pour devenir Baraka.
Il couvre la Marche pour l’égalité et contre le racisme dès ses débuts,
"Sans frontière" a joué un rôle important dans la couverture médiatique de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983. Le journal, décrit comme fait "par et pour les immigrés", disposait d’un réseau national hérité des luttes de l’immigration. C’est le lien entre les luttes militantes de l’immigration des années 1970 et de celle 1983.
Radio Galère
Radio Provisoire est une radio pirate au début des années 1980. Elle est gérée par une association loi 1901, affiliée à la FNRL Fédération Nationale des Radios Libres.
Radio Provisoire fusionnera avec Radio 13 et Radio Soleil Provence pour donner naissance à Radio Galère en 1982 (Groupement Associatif pour la Liberté d’Expression radiophonique).
Cette évolution de Radio Provisoire à Radio Galère illustre le passage des radios libres de la clandestinité à la légalité, tout en maintenant leur engagement initial pour une expression radiophonique alternative et indépendante.
Etienne BASTIDE est l’un des fondateurs avec Lucienne MUSARELLA est la première présidente de Radio Galère en 1983 et Jacques SONCIN est le directeur.
Une poignée de militants et militantes de tous horizons bidouille des petits émetteurs et fabrique des micros avec des tubes PVC, ils se mettent à diffuser le vendredi. Fritz Kuhn, un ingénieur allemand et enseignant à la faculté des sciences de Marseille fait des miracles côté technique.
Radio Galère se définit comme une radio libre, non-commerciale et indépendante de tout parti politique ou religion. Elle est reconnue pour son engagement social et militant, offrant un espace d’expression aux communautés marginalisées et aux associations locales. La radio se revendique laïque, antifasciste, antiraciste et antisexiste.
La radio propose une programmation diversifiée incluant des émissions culturelles, musicales, juridiques, et des reportages sur des sujets sociaux. Elle accueille également des collégiens et lycéens pour des ateliers et reportages.
C’est aussi l’époque où sont enregistrées les premières émissions sur les Baumettes, à l’initiative de la mère d’un des détenus. Les familles de prisonniers qui aideront à couvrir la révolte de 1987 où les détenus étaient sortis par le toit de la prison pour protester contre les conditions indignes de détention, dix ans à peine après avoir vu s’éteindre le dernier condamné à mort français, Hamida Djandoubi.
« Christine a suivi toute la marche de 1983. Elle nous appelait dès qu’elle trouvait une cabine téléphonique » Etienne Bastide
Radio Galère est connue pour son engagement social et militant, offrant un espace de parole aux communautés marginalisées et aux associations locales
Radio Gazelle
Le droit de créer des associations pour les étrangers en 9 octobre 1981, favorise l’entrée des jeunes des quartiers populaires dans le milieu associatif. Les radios libres sont légalisées, Radio Gazelle devient une radio associative.
Radio gazelle est créée le 1/7/1981 par un noyau de militants Issus de l’immigration maghrébine et attachés aux valeurs de justice et d’égalité.
Au début c’est une « radio-pirate » qui se qui émet d’un local situé dans les quartiers nord de Marseille. Les émissions sont diffusées en toute illégalité, avec un émetteur de 100 watts. A ce moment-là les étrangers n’avaient pas encore de droit de se créer en association. L’Association Rencontre et Amitié Radio Gazelle émet sur Marseille, Aix, étang de Berre sur la fréquence 98 MHz (légalement à partir du 20 novembre 1981). Kheira AIT ABBAS est la première présidente de Radio Gazelle.
La parole est donnée à ceux qui ne l’ont pas et l’expression est libre. Radio Gazelle devient « la voix des sans voix ».
Les premières émissions diffusent essentiellement des débats et de la musique maghrébine. Mais elle s’implique fortement lors des crimes racistes…
Elle s’adresse très vite aux différentes communautés qui composent Marseille. Elle favorise ainsi le pluralisme des sensibilités politiques, la diversité culturelle et la liberté cultuelle. Radio-Gazelle devient alors une radio multiculturelle et pour la première fois à Marseille raisonnent sur les ondes des voix en arabe maghrébin, arabe oriental, amazigh, créole (Antilles et Réunion), arménien, en occitan, en capverdien, en portugais, en espagnol (Espagne et Amérique latine), italien, wolof, malgache, vietnamien,…
Les émissions portent toujours un regard attentif sur les préoccupations des immigrés, la vie des différentes communautés ethniques et cherchent à favoriser les rapprochements entre les communautés.
Radio Gazelle est un outil de lutte contre les discriminations, le racisme, pour l’émancipation de la femme, pour la justice et l’égalité des droits. Et aussi un soutien aux initiatives locales et à ceux qui se battent pour la justice et l’égalité des droits. La violence et les crimes racistes amènent toute une génération à se battre au sein d’association pour demander la justice et l’égalité des droits.
Les émissions sont variées : informations, revue de presse, culture, liens avec les détenus, musique de tous les pays…
Radio Gazelle va soutenir, accueillir, accompagner la marche pour l’égalité et devient un acteur principal de celle-ci.
De nombreux animateurs de la radio vont accompagner la Marche jusqu’à son arrivée le 3 décembre à Paris.
Lorsque la Marche s’organise au départ de Marseille le 15 octobre, nombre de jeunes du quartier Bassens, flamants, Busserine, Cayolle… s’impliquent dans le comité de soutien. Radio Gazelle, dont le président est Saïd Boukenouche, joue un rôle dans l’organisation de la première étape jusqu’à son arrivée le 3 décembre à Paris.
Radio Beur
Radio Beur est une station de radio libre qui a marqué l’histoire des médias en France, notamment pour son rôle auprès de la communauté maghrébine en région parisienne.
En 1981, Radio Beur est fondée pour répondre aux besoins des jeunes issus de l’immigration maghrébine. La station commence ses émissions en 1982, dans un contexte marqué par la Marche pour l’égalité et contre le racisme.
Radio Beur se voulait un espace d’expression pour les minorités en valorisant leur culture.
En 1992, Radio Beur devient Beur FM, marquant une transition vers une radio plus généraliste. La radio adopte une programmation combinant informations, débats, musique et divertissement. Elle devient un lieu de dialogue multiculturel tout en restant indépendante et laïque.
La station quitte son statut associatif pour devenir un réseau commercial, ce qui lui permet d’accroître ses moyens de diffusion.
Elle s’étend rapidement à plusieurs villes françaises et commence à émettre au Maghreb via satellite.
En 2003, la chaîne de télévision Beur TV est créée pour compléter l’offre médiatique de la radio.
Beur FM attire progressivement un public plus large, reflétant la diversité culturelle française.
Depuis 2014, Beur FM adopte une ligne éditoriale plus variée pour toucher un public plus large, jouant un rôle clé dans la promotion du multiculturalisme et du dialogue interculturel.
Radio Soleil Goutte
La création de Radio Soleil Goutte-d’Or s’inscrit dans le mouvement des radios libres qui a émergé en France au début des années 1980 avec la fin du monopole d’État sur la radiodiffusion.
Radio Soleil Goutte-d’Or a été créée le 13 juillet 1981 à Paris. Elle est née d’une scission de Radio Soleil en deux entités distinctes, l’autre étant Radio Soleil Ménilmontant. Cette radio se définissait comme la première radio libre "immigrée et interculturelle" et "multiraciale".
La radio a été fondée notamment par :
- Saïd Bouziri (1947-2009), qui deviendra plus tard président de l’association "Génériques"
- Mokhtar Mohamed Bachiri (1947-2010)
Ces deux fondateurs étaient des militants du Mouvement des travailleurs arabes. Mogniss H. Abdallah y a également collaboré en tant que journaliste indépendant.
Radio Soleil Goutte-d’Or émettait depuis les locaux de la librairie Abencerage, située au 35 rue Stephenson à Paris. Ce lieu servait également de siège à l’association socioculturelle du quartier de la Goutte-d’Or. La radio diffusait sur la fréquence 98,25 MHz.
L’autorisation d’émettre de Radio Soleil Goutte-d’Or n’a pas été renouvelée en 1987, mettant ainsi fin à ses émissions après six ans d’existence.
Cette radio a joué un rôle important dans le paysage médiatique de l’époque, en donnant une voix aux communautés immigrées et en promouvant le dialogue interculturel dans un contexte social et politique en pleine évolution.
L’agence IM’média
L’agence IM’média est une agence de presse écrite, photographique, radiophonique et audiovisuelle spécialisée dans l’immigration, les quartiers populaires, les mouvements sociaux et les cultures urbaines. Fondée en 1983 sous forme d’association loi 1901.
IM’média a été créée dans le contexte de l’émergence sociale, politique et culturelle des nouvelles générations issues de l’immigration. Son objectif principal était de développer la communication sociale dans les quartiers populaires, offrir une formation professionnelle et faciliter l’accès aux médias.
L’agence a joué un rôle crucial dans la documentation de moments historiques importants, notamment :
- La marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983
- Les luttes contre les crimes racistes et les bavures policières dans les années 1980
- L’occupation de l’église Saint-Ambroise par 300 Africains sans-papiers en 1996
IM’média a produit divers contenus médiatiques :
- Articles et photographies pour la presse écrite généraliste et spécialisée
Émissions de télévision comme "Rencontres" sur FR3 (1989-1990)
· Documentaires tels que "Douce France, la saga du mouvement beur" (1993) et "Y’en a marre de la double peine" (1993).
IM’média a constitué un patrimoine documentaire précieux sur l’histoire des quartiers populaires et des mouvements issus de l’immigration en France. Son fondateur, Mogniss H. Abdallah s’efforce de transmettre cet héritage aux nouvelles générations.
IM’média, l’immigration par elle-même entretien avec Mogniss H. Abdallah
https://vacarme.org/article204.html
Mosaïque
Mosaïque : un laboratoire télévisuel des cultures immigrées
Diffusée chaque dimanche sur FR3 entre 1977 et 1987, cette émission s’impose comme un espace pionnier de représentation des communautés immigrées (Maghreb, Afrique subsaharienne, Portugal, Yougoslavie...).
Tewfik Farès, fondateur et réalisateur, et Mouloud Mimoun, présentateur puis rédacteur en chef, pilotent une équipe plurilingue comprenant Jean-Michel Dhermay à l’animation et des chroniqueurs comme Djelloul Beghoura (arabe), Mirjana Robin (serbo-croate), Kerem Topuz (turc), Jorge Verissimo et Luisa Lemos Viana (portugais), ou encore Guy Menga pour les communautés africaines.
Le magazine mêle plateaux musicaux et reportages engagés, offrant une tribune à des artistes tels que Salif Keïta ou Manu Dibango, tout en documentant les luttes sociales. L’émission du 11 décembre 1983 consacre 90 minutes à la Marche pour l’égalité et contre le racisme, incluant des séquences inédites comme celle d’une manifestante en larmes – un document qualifié de « l’un des plus grands témoignages politiques des années 1980 ». Après la mort de Malik Oussekine en 1986, un plateau exceptionnel est organisé place Saint-Eustache à Paris, symbole de son ancrage dans l’actualité militante.
Mosaïque explore des thématiques pionnières : un reportage à Strasbourg interroge la place des immigrés dans la construction européenne (« 13ᵉ État européen »), tandis qu’un autre à Gennevilliers popularise la notion de « deuxième génération », accompagnant l’émergence d’artistes comme Farid et Lounis Lounès. L’émission se délocalise régulièrement en région pour capter les expressions culturelles locales1.
Financée par le Fonds d’Action Sociale via le ministère du Travail, jamais intégrée au budget de FR3, elle incarne une exception dans le paysage audiovisuel français. Son audience, initialement composée à 90% de téléspectateurs issus de l’immigration, atteint 5 millions de spectateurs en 1987, séduisant un public français élargi.
Les 800 heures de programmes produits, dont une partie est en cours de numérisation à la médiathèque Abdelmalek Sayad, constituent aujourd’hui une ressource unique pour l’histoire sociale et culturelle de l’immigration en France.
Mosaïque : l’émission des cultures immigrées
Entretien avec Tewfik Farès et Mouloud Mimoun
https://shs.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2019-2-page-176?lang=fr
MOSAÏQUE, émission TV France 3.
https://www.youtube.com/watch?v=I8OG4ulARwU
Pierre Ciot photographe
Pierre Ciot est un photographe et journaliste connu pour son militantisme notamment en faveur des droits des photographes depuis les années 1970. Il occupe actuellement le poste de vice-président de la Saif (Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe) et collabore régulièrement avec la presse spécialisée dans le social et l’économie.
Pierre Ciot a débuté sa carrière en tant que photographe publiant ses premières images dans le journal Rouge de la Ligue communiste. Il a ensuite travaillé pour divers journaux, dont Libération, et a passé un certain temps à l’AFP en tant que pigiste indépendant de 1979 à 1987.
Il est impliqué dans divers projets sociaux et artistiques. Au fil des années, Pierre Ciot a réalisé plusieurs projets photographiques importants, notamment "Nés à Marseille", une série de 2000 portraits de personnes de marseillais, exposée en 2001 et publiée aux Éditions Parenthèses. Il a également reçu des distinctions, comme le prix "Air France / Ville de Paris" en 1980.
Pierre Ciot porte un regard singulier sur les questions sociales à travers ses reportages photographiques. Son travail, notamment sur Marseille, offre un témoignage unique sur l’évolution de la ville et de ses habitants.
À la fin des années 1970, il s’intéresse aux chantiers navals de La Ciotat, témoignant de l’activité industrielle et de son impact sur les travailleurs locaux. Par la suite, il explore la vie dans les cités de transit marseillaises telles que La Paternelle et Bassens, révélant les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontées ces communautés. Il rencontre des habitants, en particulier les jeunes, qui vont participer à la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983.
Il a couvert de nombreuses manifestations sur les violences et les crimes racistes ainsi que le « forum justice » organisé par l’AFMA dans le procès du crs Taillefer…
Il est un des rares professionnels à couvrir le lancement de la marche pour l’égalité et contre le racisme le 15 octobre 1983 à Marseille.
Lors de la manifestation il propose ses photos à l’AFP Marseille qui accepte de les diffuser. Ses photographies ont contribué à capturer et préserver les moments important du début de la marche. Il a donc joué un rôle important dans la documentation de cette Marche.
Les photographies de Pierre Ciot font partie d’un corpus plus large d’images documentant la Marche de 1983, aux côtés d’autres photographes comme Joss Dray, Amadou Gaye, Farid L’haoua et Mustapha Mohammadi. Ces images permettant de visualiser et de comprendre l’ampleur et l’importance de cette mobilisation. Toutes ses photos ont joué un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective de cette mobilisation pour l’égalité des droits et contre le racisme en France.
À l’occasion du 40e anniversaire de la Marche, Pierre Ciot a participé à diverses initiatives, notamment un film documentaire intitulé "Regards croisés de photographes sur la Marche". Ce projet vise à raconter l’histoire de la Marche à travers les photographies et les témoignages de ceux qui les ont prises, contribuant ainsi à ancrer cet événement dans l’histoire contemporaine.
Expressions Immigrés-Français (FASTI)
Expressions Immigrés-Français est le journal bimensuel thématique et réflexif publié par la FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Toutes les Immigrés).
Depuis sa création en 1967, la FASTI a mené de nombreuses actions importantes en faveur des droits des personnes immigrées en France.
Cette publication fait partie des efforts de communication et de sensibilisation de la FASTI, une organisation féministe, anticapitaliste et anticolonialiste qui lutte pour les droits des personnes immigrées en France.
Le journal aborde probablement des sujets liés aux activités et aux revendications de la FASTI, tels que :
- La lutte pour l’égalité des droits entre immigrés et français
- L’amélioration des conditions de vie et de travail des personnes immigrées
- La liberté de circulation et d’installation
- La lutte contre le racisme, le sexisme et la xénophobie
- Les questions spécifiques concernant les femmes immigrées
Expressions Immigrés-Français sert vraisemblablement de plateforme pour partager des analyses, des témoignages et des informations sur les enjeux liés à l’immigration en France, reflétant ainsi l’expérience de terrain et les positions de la FASTI
Bondy Blog
Le Bondy Blog est créé novembre 2005, en pleine vague de révoltes urbaines qui ont secoué les quartiers populaires français après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois. Ce média en ligne a été fondé par des journalistes suisses du magazine L’Hebdo, notamment Serge Michel et Mohamed Hamidi, avec la volonté explicite de donner la parole aux habitants des quartiers populaires, souvent absents ou stigmatisés dans les médias traditionnels.
Une quinzaine de journalistes de L’Hebdo se sont alors relayés pendant trois mois dans un petit local de la cité Blanqui de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Cette démarche de l’hebdomadaire suisse a été vue comme « un pied de nez » aux médias français, souvent accusés d’être déconnectés des réalités des banlieues.
Le Bondy Blog s’est ainsi imposé comme un espace d’expression pour raconter la réalité des banlieues, en amplifiant la voix de celles et ceux que l’on entend peu ou dont la parole est déformée. Dès ses débuts, il s’est distingué par une rédaction ouverte à tous, composée de jeunes en formation, en début de carrière ou en recherche d’emploi, issus en grande partie de la diversité française et résidant en Seine-Saint-Denis.
La vocation du Bondy Blog n’a pas changé depuis sa création : il s’agit de raconter le quotidien des quartiers populaires, de lutter contre les clichés et de participer au débat national en faisant entendre des voix minoritaires ou marginalisées par les médias dominants.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bondy_Blog